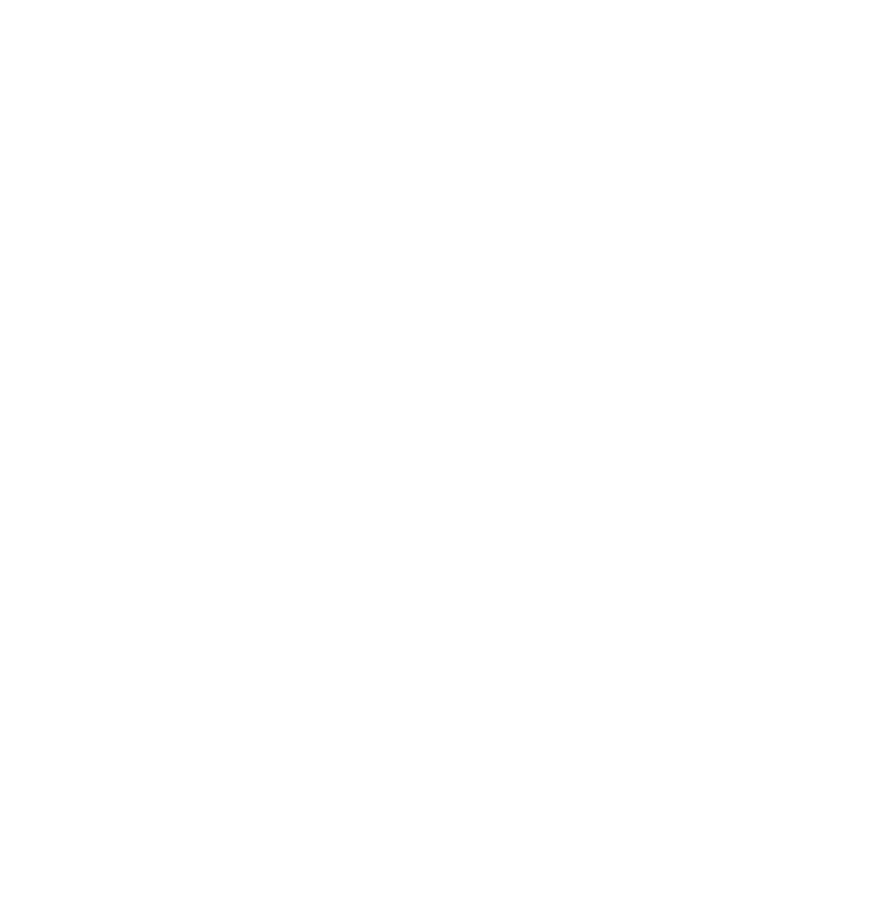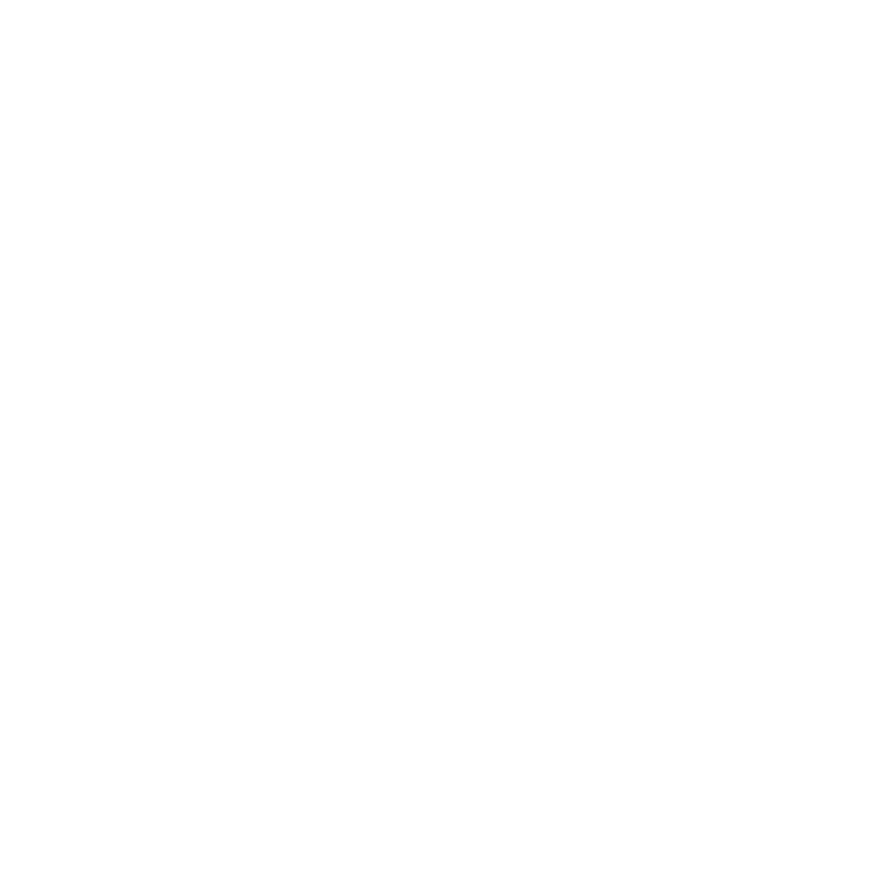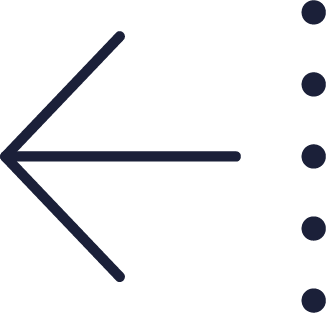Le GMHM sort de sa zone d’expertise
Présentation
4 grimpeurs du Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM) sont partis en Himalaya indien durant le mois d’octobre 2024, avec l’idée d’utiliser le parapente pour s’approcher de sommets à escalader. D’abord l’Hanuman Tibba (5982m) puis le Deo Tibba (6001m) en fonction des conditions rencontrées. Cette association s’appelle le paralpinisme. François Piotrowski, Arnaud Bayol, Cédric Rabinand et Clément Bergeron du GMHM pratiquent habituellement avec un parachute dans le dos en couronnant l’ascension d’un saut. Mais ici le parapente sera la clé d’accès à l’ascension. Parapente – alpinisme – parapente, ils rajoutent des termes à l’équation, des inconnues, tout au moins des variables… Voler en Himalaya fait rêver les paralpinistes du GMHM, et c’est dans l’air du temps. Les dernières réalisations au K2 (Benjamin Védrines, J.Y. Fredriksen, Liv Sansoz, Zeb Roche) s’ajoutent aux expéditions des dernières années au Pakistan, Népal, Inde ou en Asie centrale par des paralpinistes renommés tels que Damien Lacaze, Julien Duserre, Antoine Girard, Sébastien Brugalla, François Ragolski ou Tom de Dorlodot pour citer quelques francophones. Les images sont souvent sublimes et l’enthousiasme apparent peut cacher la difficulté de ce type de projet. Les alpinistes du GMHM sont allé tenter leur chance et livrent ici leurs premières observations.
À Chamonix le 15 novembre 2024
Ça fait une semaine que nous sommes rentrés en France et l’envie d’y retourner se manifeste déjà. L’Himachal Pradech est une région sublime. Arrivés à Bir nous sommes sur le piémont himalayen. À 1400m d’altitude le paysage se redresse soudainement pour atteindre 5000m d’altitude 10km au nord. En bas il fait 20 degrés ce qui est très agréable à ces latitudes. Le soleil est présent tous les jours, presque pas de vent. Les journées instables peuvent partir à l’orage dès 14h sinon le soleil brille jusqu’au soir. À 9h déjà la thermique s’élève et des « barbules », qui sont dans le jargon de petits nuages au sommet des ascendances, sont visibles. Le potentiel est énorme d’autant qu’il y a peu de limitation de vol en Inde. Arrivés sur place il faut demander un permis à l’organisation locale qui nous communique une liste de zones interdites : en somme les emprises militaires ainsi qu’une « no landing zone » 40km au SE et une « no flying zone » 40k WNW. Le reste c’est le terrain d’aventure. Au sud la plaine, au nord la chaine himalayenne.
La préparation :
En France la saison n’a pas été optimale et notre entrainement à 4 s’est réduit au maximum. Entre les impératifs de chacun et une météo capricieuse nous avons fini par convenir que les 3 premières semaines à Bir seraient dédiées à ces « réglages ». Voler à 4 n’est pas simple surtout si ce vol est suivi d’une ascension. Nous voilà donc à Bir avec nos voiles habituelles qui seront ici nos véhicules de transport. Avec François nos « Zeolite » en S n’offrent que 85kg de PTV max (Poids Total Volant), pour faire simple il ne faut prendre que 10kg de matériel, eau, vivres. Clément est notre joker car son « Alpina 4 » un peu grande pour lui sera ici un atout. Quant à Cédric, il aura les mêmes contraintes de PTV que nous. Voilà déjà une première problématique. La seconde va apparaitre dès la deuxième semaine et sera la sur-fréquentation du site de Billing, notre zone de décollage. Il n’y a finalement que peu de sites accessibles pour décoller et l’engouement du parapente dans cette région est international. En gros c’est la queue au décollage, puis la guerre dans le thermique. Tu dois régulièrement éviter un pilote ingénu ou néophyte. Et quand l’objet du jour est de s’extraire à 4 pour transiter en montagne il est possible de perdre son calme. Heureusement l’ambiance est plus détendue qu’à Annecy donc ça passe encore. L’option sera alors de laisser passer la première vague. Mais cette solution ne fonctionne qu’au début car des nuages se forment rapidement et occupent le ciel juste au-dessus de Billing la zone de décollage. Et à ce moment-là l’ingénu c’est toi ! Car évidemment tu ne voles pas dans les nuages. Alors qu’elle est ta surprise quand, aux abords d’un nuage, surgit un ignorant joyeux (euphémisme d’imbécile heureux) que tu dois éviter. Mais tout cela fait partie de notre apprentissage de l’écosystème volant et comme nous étions correctement acclimatés à 4000m en France, nous partons sans hésiter vers la seconde phase du projet, la partie principale qui débute à Manali.
Les projets :
Attention spoiler, nous n’en avons réussi aucun !
La vallée de Manali est une entaille N/S fermée au nord par des montagnes culminant à 6000m et ouverte 75km au sud. L’endroit semble propice au paralpinisme car il est assez facile d’y voler (globalement peu de vent), en journée au mois d’octobre la brise est faible, et des gros reliefs jouxtent directement la vallée avec notamment l’Hanuman Tibba 5982m à l’ouest et l’Indrasan 6221m en face.
Un décollage fréquenté par les biplaceurs locaux est situé sur la route qui mène au col de Rohtang. Il permet de décoller à 3600m d’altitude. Au pied de l’Hanumam un autre site officiel est situé à Solang et utilise la télécabine pour prendre 450m de hauteur au-dessus du posé. Mais l’extraction est difficile et les cabines ne fonctionnent qu’à partir de 11h. Pour notre projet qu’est l’Hanuman Tibba le Rohtang pass semble être la meilleure option, car nous devons sortir haut (5200m environ) et tôt pour transiter vers une face E sur laquelle nous devons atteindre 5400m et se laisser glisser au pied de l’Hanuman. Pour compliquer la chose, lors des journées claires un fort vent catabatique nous barre le décollage et ne se calme qu’à 11h30. Nous parlons là d’une brise descendante mesurée à 100km/h à l’anémomètre. D’essais en tentatives les jours se sont égrainées inexorablement. Par deux fois 2 pilotes sur 4 auraient pu se jeter au pied l’Hanuman mais le manque de plafond rendait la prise de décision trop courte. Il faut préciser aussi que nous avions convenus d’un minimum de 3 pilotes sur 4 pour se poser. Cette décision préalable tenait au fait qu’en cas de blessure il est quasi impossible, seul, de transporter un blessé. Car sans le parapente rentrer du pied de l’Hanuman Tibba demande 2 jours de marche. Mais nous n’étions qu’à un fil de la réussite car ensuite l’ascension alpine semblait débonnaire et nous n’aurions pas hésité à charrier notre sac de 20kg jusqu’à Manali si toutefois le redécollage de l’Hanuman avortait. Enfin Nicolas notre routeur annonça que les 5 derniers jours allaient être stables. La prophétie se concrétisa par des thermiques culminant à seulement 4000m. Même les biplaceurs locaux nous confirmèrent que la saison 2024 allait se clore. Pour profiter de ses quelques jours de beau temps avant l’hiver nous avons donc abandonnés nos parapentes et nous avons grimpé au sommet du Shitidhar 5294m pour chanter nos louanges à Hanouman, le dieu singe capable de survoler l’himalaya. Les deux ukulélés ont retentis dans un décor de rêve !
Conclusion ou amorce d’une réflexion ?
Il est souvent aisé de dire que l’échec est lié à la météo. Oui ici, l’aérologie ne nous a pas permis de réaliser l’approche sous la forme que nous l’avions imaginé. Mais avec une meilleure expérience du lieu nous aurions pu choisir un itinéraire ou un projet plus adapté. Cette première expérience nous a donc beaucoup appris sur ce site. Ensuite nos habitudes et nos logiques d’alpinistes ont été confronté à un nouveau contexte, plus dynamique, qui demande une meilleure connaissance de nous-même et des autres.


- La logique de cordée mise en difficulté par le parapente
Le déplacement en parapente bouscule nos habitudes de terrien : le mouvement permanent et l’arrêt impossible empêche de se réunir pour décider collégialement. En montagne, face à une difficulté ou face à un choix nous partageons la prise de décision. Alors chacun peut donner son avis, ses enthousiasmes, ses craintes ou rendre compte de sa fatigue. Je me rappelle d’un moment compliqué où nous étions en antarctique dans un fort vent, lancés à 60km/h sur nos skis tractés par nos kite. Quand la communication fut trop compliquée le premier s’arrêta et nous avons monté une tente pour nous abriter et décider posément de la suite. Mais cette solution n’est pas la meilleure en parapente car il peut être délicat d’atterrir. C’est donc le premier qui prend la décision et engage les autres à le suivre ou à abandonner. En parapente il y a des temps forts où lâcher les commandes n’est pas une bonne idée et des temps calmes où il est possible de parler à la radio. Par exemple j’étais au cœur d’un thermique quand, à la radio, on cherche à me joindre « Arnaud t’es où, on va où maintenant ? » agacé de devoir répondre je lâche ma commande extérieure et saisi la radio. Mon bout d’aile ferme et je me retrouve avec une cravate difficile à résoudre. Ce genre de situation fait monter le stress du pilote.
- Dans un contexte aussi dynamique l’effectif du groupe est problématique.
Si j’arrive dans un thermique et que le second suit, il se peut que le troisième se retrouve hors cycle. Il faut donc essayer de l’attendre au sommet du thermique. En Himalaya au sommet d’un thermique à 5000m d’altitude (ce qui n’est pas si haut pour le massif) il fait froid. Dans une autre configuration on ne peut tout simplement pas attendre au sommet du thermique car il y a un nuage et il faut accepter de redescendre pour recommencer le travail d’enrouler avec ses compagnons. Mais il est des thermiques où l’ascension n’est pas de tout repos. Tout cela énerve un peu plus le pilote qui était déjà en état de vigilance avancé depuis des heures.
- La prise de décision du premier impacte les autres.
La confiance est donc obligatoire et contrairement à la cordée, un parapentiste ne peut rien pour un autre parapentiste.
Exemple : Dilemme entre se poser près d’un pilote dans un compartiment de terrain difficile ou le laisser et continuer le vol. celui qui est au sol doit alors vite informer de son état à la radio et dire « ok tout bon je me débrouille pour rentrer »si tel est le cas, pour éviter que le second pilote ait à poser au même endroit avec une possible mise en danger à son tour. Si un accident survient, comment alors intervenir sans sur-accident ? le délai de réflexion est court et il ne sera bientôt plus possible de décider.




- Le facteur humain encore et toujours.
Cette activité « portée » semble peu énergivore. Mais ici on vole tous les jours et la fatigue nerveuse devient réelle. Car le pilote doit anticiper des conditions aérologiques souvent invisibles et variables, le décollage peut être compliqué, les atterrissages restreints, le vol instable en cas de vent ou de fortes conditions. La différence d’appréciation ou d’appréhension est directement fonction du niveau technique et du matériel de chacun. La fatigue mentale, insidieuse, met la patience et la tolérance à rude épreuve. Les premiers accrochages avec les compagnons peuvent alors survenir.
- Une autre grande différence avec l’alpinisme :
En atterrissant sur une montagne la problématique de la descente n’a été abordée que théoriquement. En alpinisme on peut appliquer la règle d’engagement suivante : pendant que je suis capable de redescendre alors je peux continuer à grimper. En parapente je ne suis pas certain de pouvoir redécoller. Pas certain d’avoir le matériel et le niveau physique de redescendre à pied. Donc l’ascension par les airs est une étape mais la redescente en est une seconde à part entière pour laquelle je n’ai levé aucune inconnue durant la monté. Ma prise de décision ne sera guidée que par ma faculté d’analyse, d’anticipation et par ma rapidité de prise de décision (oui le parapente avance toujours !). Et comme nous l’avons vu précédemment la décision collégiale par la réunion n’est pas possible car chacun est à un moment différent du vol et déjà pleinement occupé à piloter son aéronef.
La confiance et la préparation en amont sont alors essentielles car la communication est limité et car chacun ne peut juger que du point de vu où il se trouve.
Sur le choix du matériel il faut être à l’aise avec son aéronef afin de dégager un maximum de concentration en vue de la prochaine décision. Il peut être intéressant que les pilotes aient des ailes semblables pour qu’ils rencontrent les mêmes problématiques. Un pilote avec une aile performante n’appréhendera pas de la même manière une longue transition face au vent ou un long itinéraire en cheminement qu’un pilote avec une voile moins performante. Au contraire le pilote avec une aile plus exigeante sera moins serein dans des conditions turbulentes. À ce moment-là ce sera le pilote avec l’aile tolérante qui se dégagera le plus de capacité de réflexion.
Tout cela nous semblait évidant avant de nous retrouver dans le grand bain, mais force de constater que nous avons dû faire face à des échecs, des désaccords et des frustrations. Mais de mon point de vue ce fut une expérience géniale, riche d’apprentissages et qui m’a sorti de ma zone d’expertise.
Pour finir sur ce mot « l’expertise » c’est sans doute François qui était le plus expérimenté en parapente lors de cette aventure. Il est coutumier des compétitions et inscrit dans le cycle du brevet d’état. Malgré cela il a dû faire face à des situations inhabituelles. Clément et Cédric eux sont instructeurs militaires de parapente et sont de fait expert du parapente militaire. Mais ce savoir-faire a t’il été utile ici ? pour ma part, seulement BPC je n’étais pas surpris de ne rien connaitre mais j’en étais pas moins avancé !
En tout état de cause nous ne pouvons pas nous positionner comme des experts de cette discipline d’autant que le GMHM baigne dans une culture et une histoire d’alpinisme classique. Mais il est évident que cette expérience himalayenne en parapente nous aura ouvert sur de nouvelles réflexions à propos de la prise de décision dans un univers dynamique et sur la gestion des risques liés à celui-ci.